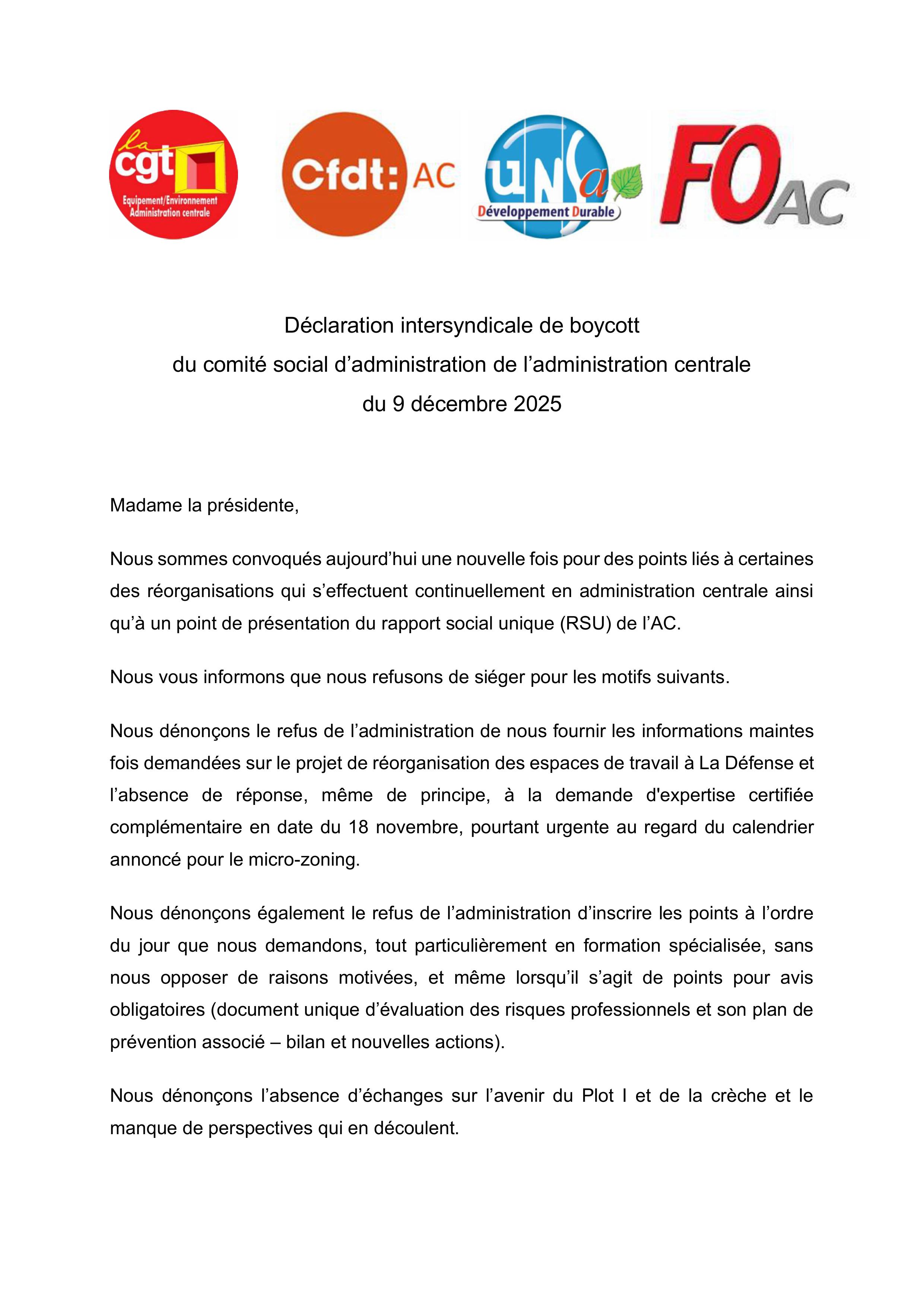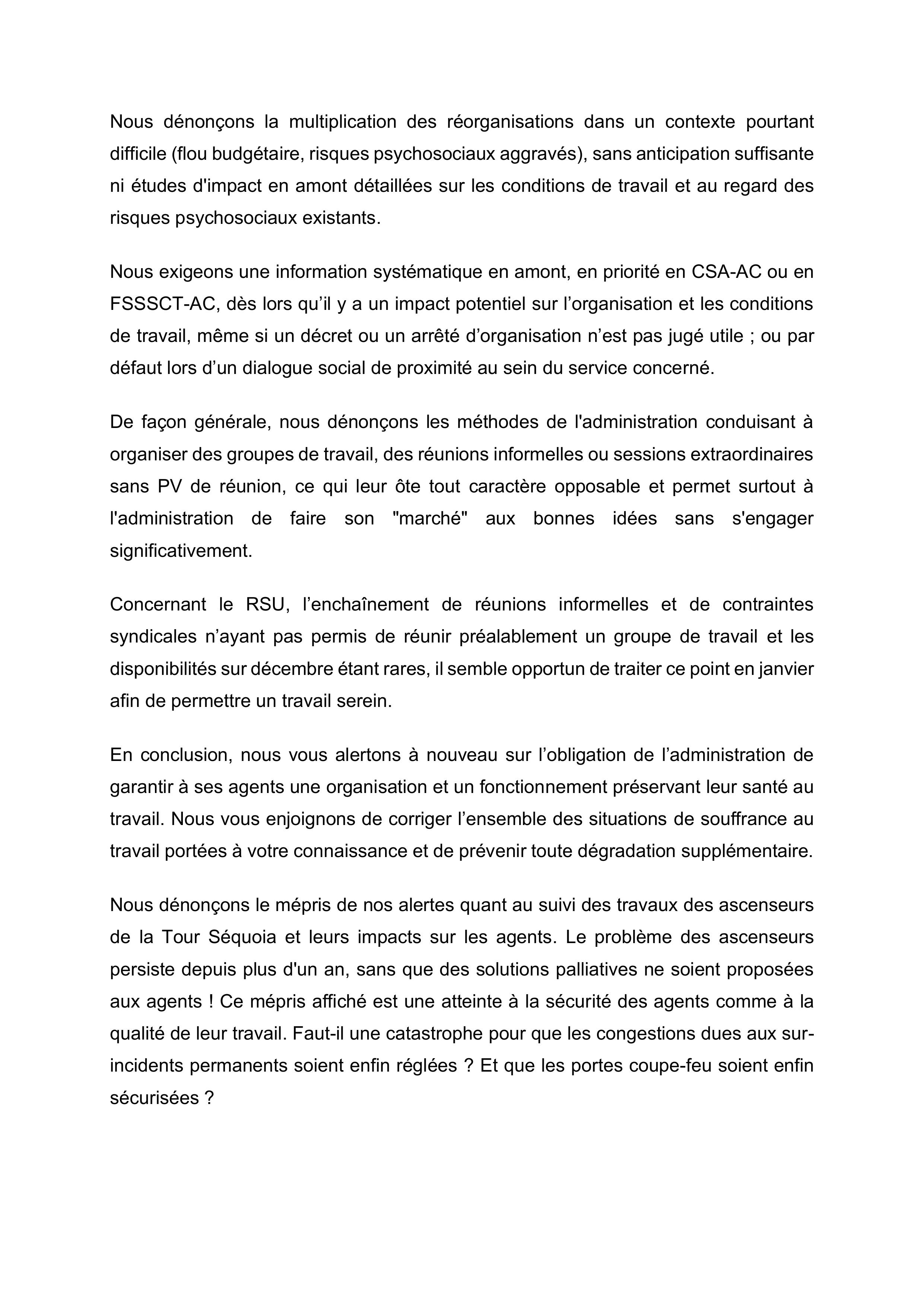Mise en œuvre de l’accord handicap au rabais
 L’accord relatif à la politique menée aux ministères (Transition écologique, Aménagement du territoire, Transports, Ville et logement) en faveur des agents en situation de handicap, signé en 2022 par le SG des ministères et les fédérations FNEE-CGT, FEETS-FO, CFDT-UFETAM, FSU et UNSA-DD expire le 31 décembre 2025.
L’accord relatif à la politique menée aux ministères (Transition écologique, Aménagement du territoire, Transports, Ville et logement) en faveur des agents en situation de handicap, signé en 2022 par le SG des ministères et les fédérations FNEE-CGT, FEETS-FO, CFDT-UFETAM, FSU et UNSA-DD expire le 31 décembre 2025.
L’administration souhaite sa reconduction pour un an par pur formalisme.
Cet accord Handicap, applicable aux agents en administration centrale, dans les services à compétence nationale et déconcentrés, dont les agents affectés en Direction Départementale Interministérielle (sous réserve du respect des prérogatives propres relevant du ministère de l’Intérieur), comporte 2 axes : déploiement d’une politique d’emploi et de maintien dans l’emploi et structuration renforcée des ressources (formations, communication, travail en réseau).
Il promeut également un suivi de sa mise en œuvre qui ne s’est pas réalisé dans les faits.
Mardi 9 décembre 2025 se tenait le dernier comité de suivi de l’accord handicap ministériel.
Plus de 20 ans que la Loi Handicap a été publiée et devrait être une réalité pour tous.
Le pôle ministériel est en charge de sa déclinaison, mais constat est fait de l’absence de mise en œuvre uniforme sur le territoire. Ainsi cette année encore, chacun s’émeut de voir mis en place, de façon disparate selon les zones de gouvernance, des actions d’information, de formation, de sensibilisation, des duodays...
L’accord Handicap expire et il n’y a toujours pas d’évaluation de ses actions, de bilan, de cartographie des référents handicap, des formateurs 1ers secours en santé mentale, de « qui fait quoi », de guide véritablement « accessible ». Chacun reste dans son coin.
Le recensement des BOETH (bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés) est incertain.
L’accord Handicap mentionne qu’en 2020, le ministère comptait 2 888 BOETH.
Le Rapport Social Unique 2024 (dont le périmètre des agents pris en compte fluctue selon la thématique abordée et en tous les cas diffère de celui de l’accord précité), présenté au dernier CSA ministériel, identifie un effectif quasi stable de BOETH depuis 3 ans : 2 552 agents identifiés en 2024, 2 436 en 2023, 2 473 en 2022.
Mais un doute subsiste sur ce recensement, que l’administration n’a pu lever lors de ce comité de suivi : n’y aurait-il pas des doubles comptages ? Par exemple, les fonctionnaires titulaires, en activité, atteints d’une invalidité à la suite d’un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou à la suite ou d’une maladie professionnelle ne seraient-ils pas comptabilisés deux fois : en tant que cette situation leur permet de bénéficier de l’Ati (allocation temporaire d’invalidité) et ensuite en tant qu’ils bénéficient de la RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) ?
Incertaine, l’administration propose de revoir tout cela l’année prochaine.
La convention avec le FIPHFP n’a été que partiellement mise en œuvre.
La convention C-1734 a été passée entre les ministères et l’établissement public national FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) pour une période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 et pour un montant de 2 500 615 €.
Le Rapport Social Unique 2024 dresse un sous-emploi des aides allouées : 726 000 € ont été utilisés en 2024 et 554 700 € en 2023, presque exclusivement sur l’axe de la convention lié au maintien dans l’emploi. Il n’y a eu aucun financement FIPHFP sur l’axe relatif à l’accessibilité numérique ou encore sur celui relatif à la formation des agents et des tuteurs en relation avec les travailleurs handicapés.
L’administration a indiqué qu’en raison de la tardiveté du virement du FIPHFP (intervenu en novembre 2025) et des dépenses des régions encore en attente, une prolongation d’un an de la convention avait été conclue, avec transfert de crédits entre les différents axes (sans plus de précision).
Mardi 9 décembre 2025, au motif du parallélisme des actes, l’administration propose la prorogation de l’accord Handicap.
Sans bilan de la mise en œuvre de cet accord, sans retour d’expérience synthétique, sans bilan des médecins du travail… bref sans justification autre que celle de vouloir faire coexister la convention FIPHFP et l’accord Handicap sur la même durée, l’administration souhaite proposer aux organisations syndicales, la signature d’un avenant à l’accord.
A suivre.
COMITE SOCIAL D’ADMINISTRATION CENTRALE : L’intersyndicale boycotte la réunion du 9 décembre 2025 !
 Le comité social d’administration centrale devait se tenir le mardi 9 décembre 2025 à14h30.
Le comité social d’administration centrale devait se tenir le mardi 9 décembre 2025 à14h30.
Toutefois, l’intersyndicale FO-UNSA-CFDT-CGT, après lecture d’une déclaration liminaire, a décidé de boycotter cette réunion, compte tenu des conditions dans lesquelles se déroule le dialogue social depuis plusieurs mois.
La méthode suivie par l’administration concernant le projet immobilier Arche-Sequoia 2028 en est un bon exemple, entre la non-prise en compte dans des délais raisonnables de nos demandes d’expertise certifiée sur le projet, la diffusion d’informations lacunaires dans les instances représentatives et une concertation très insuffisante avec les représentants du personnel.
Plus largement, l’intersyndicale s’élève aussi contre la récurrence des réorganisations dans un contexte incertain pour les agents et les carences de l’administration en matière de qualité de vie au travail, ainsi qu’en témoigne la situation matérielle de plus en plus intenable des agents en tour Sequoia, qui subissent au quotidien les inconvénients liés à l’état des ascenseurs et les problèmes de températures. Sans compter les aléas techniques affectant fréquemment les réunions en distanciel.
Une situation indigne d’un Etat moderne et nuisible, de surcroit, à l’image de notre pôle ministériel.
Il nous apparaissait donc nécessaire de réagir, sans préjudice d’actions ultérieures.
A noter que nous avons souhaité déposer notre déclaration liminaire auprès du Secrétaire général mais il n’a pas été jugé bon de nous ouvrir la porte de son bureau, restée hermétiquement close.
Tout un symbole.
Vous trouverez ci-dessous la déclaration liminaire de l’intersyndicale en CSA d’administration centrale.
L’UNSA demande l’inscription du congé menstruel dans la loi
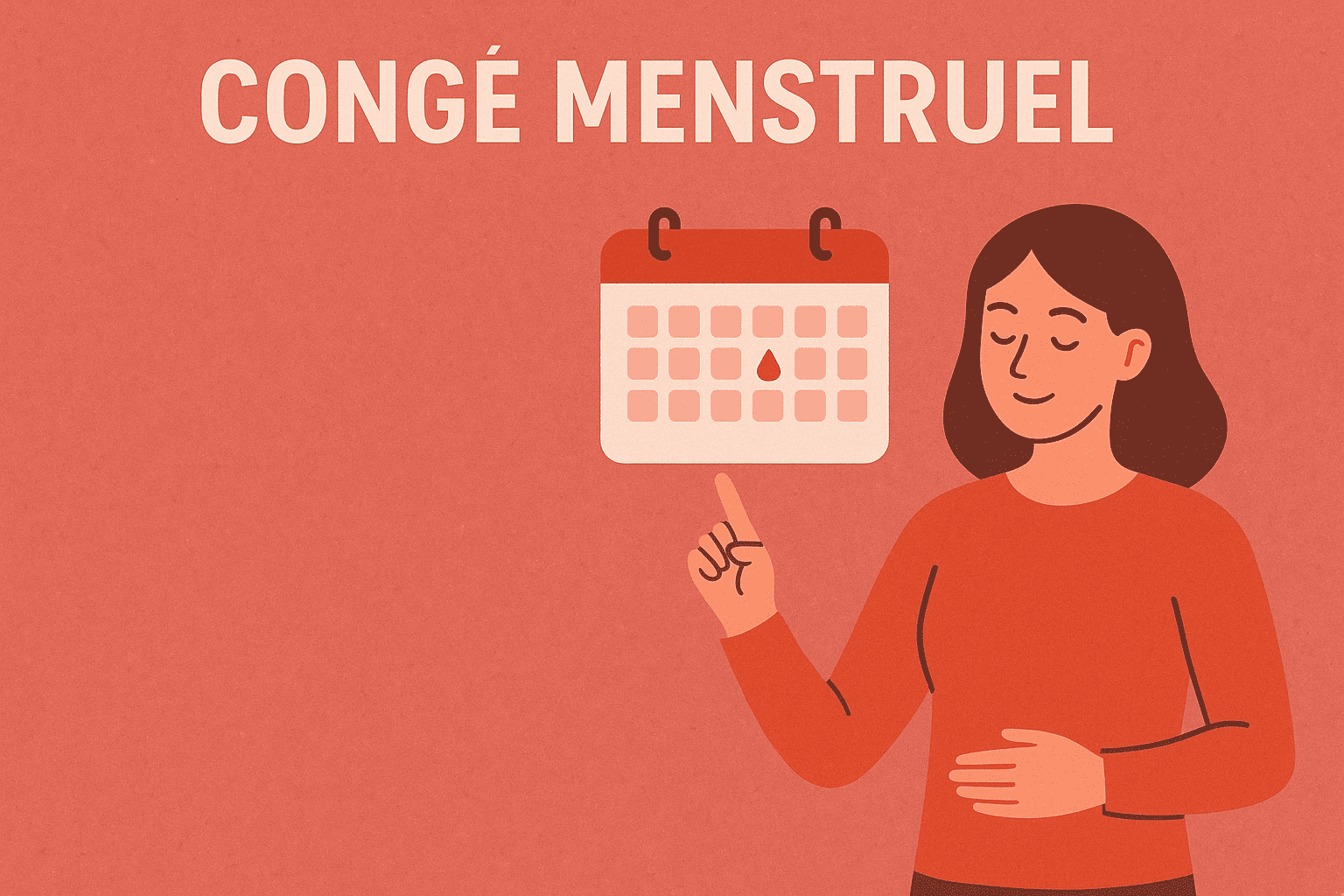 Déjà plus 5000 signataires, et vous ?
Déjà plus 5000 signataires, et vous ?
Pour signer la pétition c’est ici
Chaque mois, en raison de leurs règles, des millions de femmes subissent douleurs intenses, migraines, malaises, vomissements ou fatigue extrême. Ces symptômes peuvent impacter leurs journées de travail, sans pour autant être reconnus comme un motif d’arrêt. L’Espagne l’a fait, pourquoi pas la France.
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes demande l’inscription du congé menstruel dans la loi. Cette proposition est déjà soutenue par des milliers de signataires.
Le congé menstruel : un clivage de genre et générationnel
Cette revendication est majoritaire. L’indice UNSA du moral des salariés de décembre 2025 le prouve.
- 65 % des femmes considèrent que la prise en compte de la santé féminine dans leur entreprise ou organisation n’est pas satisfaisante.
- La mise en place d’un congé menstruel, si elle est majoritaire (52 % des répondants y sont favorables), met cependant en lumière des clivages de genre ou d’âge.
Un premier clivage de genre apparaît :
- 56% des femmes se prononcent en faveur de la mise en place des congés menstruels, contre seulement 47% des hommes.
- Des divergences plus fortes encore se manifestent d’un point de vue générationnel : les congés menstruels sont plébiscités parmi les 18-24 ans (85%) tandis qu’ils sont majoritairement rejetés chez les 50-64 ans (59%).
Les personnes interrogées sont cependant majoritairement d’accord (58%) pour dire que la mise en place d’un congé menstruel serait une mesure utile pour améliorer le bien-être au travail. A nouveau, le critère de l’âge est très discriminant : quasi-unanimité chez les 18-24 ans (95%), alors qu’une majorité des 50-64 ans pense le contraire (57%).
L’UNSA lance une pétition pour inscrire le congé menstruel dans la loi
L’UNSA considère qu’il s’agit d’un véritable enjeu d’égalité au travail : personne ne devrait avoir à choisir entre souffrir ou perdre une journée de salaire. Il est temps de lever les tabous et d’accorder à toutes les personnes concernées un droit au congé menstruel garantissant équité et mieux-être au travail.
L’UNSA demande l’inscription dans la loi d’un arrêt de travail spécifique, pris en charge et sans jour de carence, un congé menstruel rémunéré et confidentiel.
Toutes et tous mobilisé.e.s : déjà plus de 5 000 signataires !
L’UNSA lance une pétition ouverte à toutes et tous pour porter cette revendication auprès du gouvernement et des parlementaires. Cette campagne nationale appelle à reconnaître pleinement la réalité des douleurs menstruelles et leur impact sur la vie professionnelle.
L’UNSA encourage chacune et chacun, dans les entreprises, organisations, collectivités et universités, à signer et à partager cette pétition pour faire avancer ce droit fondamental de santé et d’égalité.
Les douleurs de règles ne doivent plus être un tabou, ni un obstacle au travail.
Pour signer la pétition : congemenstruel.fr
Mobilités durables : forfait à demander avant le 31 décembre 2025
 Le forfait "Mobilités durables" est accessible dans les trois versants de la Fonction Publique.
Le forfait "Mobilités durables" est accessible dans les trois versants de la Fonction Publique.
Pour 2025, les agents doivent déposer leur demande avant le 31 décembre 2025. L’UNSA Fonction Publique détaille les principales dispositions.
Montant du forfait "Mobilités durables"
Le forfait "Mobilités durables" a été créé pour favoriser les déplacements alternatifs des agents de leur domicile à leur lieu de travail.
Un minimum de 30 jours par an d'utilisation d'un ou plusieurs moyens de transport éligibles permet l'accès au forfait mobilités durables. Le nombre minimal de jours est modulé suivant la quotité de travail de l'agent.
Le montant annuel est de :
- 100 € pour une utilisation de moyens de transport éligibles entre 30 et 59 jours,
- 200 € pour une utilisation de moyens de transport éligibles entre 60 et 99 jours,
- 300 € pour une utilisation de moyens de transport éligibles d'au moins 100 jours.
Pour inciter les agents publics à utiliser des modes de déplacements alternatifs, l'UNSA Fonction Publique demande l'augmentation du montant du forfait "Mobilités durables" à hauteur de 800 € annuels, comme pour les salariés du privé.
La demande est à déposer avant le 31 décembre 2025 pour les déplacements effectués pendant l'année 2025. Une déclaration sur l'honneur certifiant le nombre de jours d'utilisation d'un ou plusieurs des moyens de transport éligibles est suffisante. L'employeur demandera un justificatif pour le covoiturage. Les autres modes peuvent faire l'objet d'un contrôle.
Moyens de transport permettant l'accès au forfait "Mobilités durables"
Le déplacement doit avoir lieu entre la résidence habituelle de l'agent et son lieu de travail et non d'affectation.
Sont éligibles au forfait "Mobilités durables" :
- le covoiturage, en tant que conducteur ou passager,
- les déplacements en cycle personnel à pédalage assisté ou non,
- les engins de déplacement personnel motorisés : trottinette électrique, monoroue, hoverboard, gyropode...
- l'utilisation de services de mobilité partagée : location ou utilisation en libre-service de cyclomoteur, mobylette, cycle à assistance électrique ou non, engin de déplacement motorisé, à condition qu'ils soient à moteur non thermique,
- les services d'autopartage si les véhicules mis à disposition sont des véhicules à faibles émissions.
L'UNSA Fonction Publique revendique l'extension aux transports en commun autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement.
Cumul avec une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement
Les abonnements des frais de transports publics ou d’abonnement à un service public de location de vélo sont remboursés partiellement par l'employeur.
Ce remboursement est cumulable avec le forfait mobilités durables, à condition que cette demande ne concerne pas le même abonnement. Par exemple, un agent pourra utiliser successivement pour un même trajet le train, puis un service de mobilité partagée et prétendre au remboursement partiel de son abonnement et au forfait mobilités durables.
Agents éligibles
Les agents fonctionnaires (titulaires ou stagiaires, civils et militaires) et contractuels des trois versants peuvent percevoir ce forfait mobilités durables.
Il s’agit d’un dispositif obligatoire pour les employeurs de la FPE et de la FPH. Il est facultatif pour les employeurs de la FPT. Dans ce cas, les modalités d’octroi sont définies par l’organe délibérant de la collectivité territoriale, de son groupement ou de son établissement public.
Dans les versants territorial et hospitalier, les agents recrutés sur un contrat de droit privé bénéficient du forfait mobilités durables.
Ne sont pas éligibles à ce dispositif :
- les agents bénéficiant d’un logement de fonction sur leur lieu de travail,
- les agents bénéficiant d’un véhicule de fonction (et non de service),
- les agents bénéficiant d’un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail,
- les agents transportés gratuitement par leur employeur,
- pour la FPE, les agents en service à l’intérieur de la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports parisiens qui, en raison de l’importance de leur handicap, ne peuvent utiliser les transports en commun et bénéficient d’une allocation spéciale.
Il y a urgence à changer les habitudes de déplacement du quotidien. Il faut s'en donner les moyens et les employeurs publics doivent donc être exemplaires.
Pour l'UNSA Fonction Publique, il est indispensable que l’État, les établissements de santé et les collectivités locales permettent aux agents publics de s’inscrire dans la sobriété énergétique dans leurs déplacements.
Une fonction publique inclusive pour les personnes en situation de handicap
 À l’occasion de la « Journée internationale du handicap » le 3 décembre 2025, la fonction publique se doit d’être en première ligne pour favoriser une société inclusive.
À l’occasion de la « Journée internationale du handicap » le 3 décembre 2025, la fonction publique se doit d’être en première ligne pour favoriser une société inclusive.
L’UNSA Fonction Publique, notamment au sein du FIPHFP, impulse une politique active d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnels en situation de handicap, contribuant ainsi au progrès social et à la valorisation de tous les agents publics, quel que soit leur handicap.
Rôle du FIPHFP
Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) est l’acteur central de cette politique. Il finance l’insertion, le maintien dans l’emploi, la formation et l’aménagement des postes, en partenariat avec les employeurs publics et les agents. Il agit comme catalyseur de l’action publique et incite les administrations à remplir leurs engagements en matière d’inclusion.
L’UNSA Fonction Publique joue un rôle important au sein du FIPHFP en participant activement à la définition et à la mise en œuvre de la politique du handicap dans la fonction publique. Elle milite pour l’ouverture de négociations nationales sur le handicap afin d’adapter la politique de la fonction publique aux réalités des agents publics.
Handicap visible et invisible
Le handicap dans la fonction publique couvre aussi bien les situations visibles (physiques, sensorielles) qu’invisibles (maladies chroniques, troubles psychiques, cognitifs ou du développement).
L’UNSA Fonction Publique participe activement à des groupes de travail sur les dispositifs existants qui permettent d’accompagner les agents tout en respectant leur désir de discrétion et en organisant une écoute adaptée.
Maintien dans l’emploi
L’UNSA Fonction Publique, au sein du FIPHFP, encourage le financement de solutions favorisant l’élaboration d’outils et de dispositifs de soutien, comme les parcours de maintien dans l’emploi des agents publics. Grâce à des outils et des conventions spécifiques, elle participe au soutien et à l’accompagnement des agents dans leur parcours professionnel malgré les situations de handicap. Cette démarche vise à renforcer la coopération entre les acteurs du maintien dans l’emploi et à garantir la continuité des carrières.
Approche intégrée du handicap
L’UNSA Fonction publique défend une politique humaine intégrée du handicap dans la fonction publique, qui concerne tous les pans des ressources humaines : recrutement, formation, carrière, conditions de travail et aménagements raisonnables. Cette démarche partenariale implique les professionnels RH, les experts du handicap, les encadrants et les agents eux-mêmes, afin de s’adapter à leurs besoins spécifiques.
Objectif pour 2030
Le FIPHFP s’est fixé pour objectif d’atteindre le taux légal d’emploi de 6% des personnes handicapées dans chaque versant de la fonction publique et chaque ministère d’ici 2030.
Pour l’UNSA Fonction Publique, cette ambition doit aller plus loin, pourquoi ne pas fixer un objectif de 7% plus proche des réalités ? Cette ambition s’inscrit dans une dynamique globale d’amélioration de la qualité de vie au travail et de prévention, avec le renforcement des expertises et des outils.
L’UNSA Fonction Publique est engagée dans une démarche inclusive et structurante pour les personnels en situation de handicap. Dans ce cadre, elle incite les agents à faire reconnaître leur handicap, dans une volonté collective de faire évoluer les mentalités et les pratiques pour une inclusion plus juste et plus solidaire.